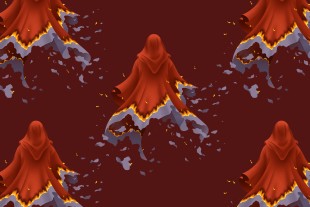Rencontre avec Marie-Ève Signeyrole | Médée
Transcription textuelle
Rencontre avec Marie-Ève Signeyrole autour de la production Médée
« Cherubini a choisi de raconter l’histoire de Médée au moment où Médée et Jason sont en Corinthe, dans leur pays d’asile.
La Corinthe c'est l’actuelle Grèce.
Jason décide de répudier Médée pour épouser Dircé, la fille du roi de Corinthe, en échange de quoi, il offrira au roi la toison d’or.
Médée, contrariée par cette séparation et ce nouveau mariage, décide de se venger et d’assassiner Dircé, la nouvelle épouse de Jason.
Puis la vengeance se poursuit, Elle décidera d’assassiner les enfants qu’elle a eues avec Jason sur cette terre d’asile.
Médée pour moi c’est une femme assez extraordinaire parce qu’elle est à la fois mi-déesse, mi-reine. Elle est épouse, elle est maîtresse, elle est mère et elle est surtout étrangère.
Et c’était la première chose qui nous intéressait avec le dramaturge Louis Geisler, c’était de se dire comment peut-on traiter de la question de l’étranger à travers ce livret. De l’étranger et du monstre.
Cette femme a tout quitté, elle a quitté son pays, sa patrie, les siens. Elle a quitté ses mœurs, sa culture, sans doute sa religion et elle se retrouve étrangère sur une terre d’asile qui la répudie. Donc elle est, en quelque sorte, étrangère à tout et même étrangère à elle-même et son seul lien, ses seules racines se trouvent être ses enfants, qu’elle décide finalement d’assassiner pour les emmener avec elle, ayant peur que ses bourreaux réservent le même sort à ses enfants qu’à elle-même.
Comment on passe très vite de l’image de la magicienne à celle de la sorcière et comment, finalement, on passe très vite de la question de l’étranger à celle du monstre, c’est-à-dire que l’étranger est celui qui nous fait peur parce qu’il ne nous ressemble pas. Et c’était un peu notre façon d’éclairer le visage de cette femme, qui n’est pas un monstre pour nous, et de dire que c’est sans doute la société qui créé les monstres, la société autour d’elle.
Ce qu’il faut savoir, c’est que Médée c’est un mythe qui a été écrit et réécrit à travers les siècles par des hommes, principalement, par des couches successives. Et ces dernières années, depuis une trentaine d’années, des autrices revisitent le mythe de Médée en s’interrogeant sur le geste de l’infanticide.
Et on retrouve dans les racines du mythe certains versions où c’est le peuple de Corinthe lui-même qui assassine les enfants. Du coup, on s’est posé la question de l’infanticide, qui est un geste tabou puisqu’une mère qui tue ses enfants, c’est le crime ultime pour la société.
On s’est demandé comment ce geste, non pas pour l’excuser mais pour l’expliquer, comment ce geste pouvait avoir lieu. On a donc, avec mon dramaturge, recherché des pistes, des traces de ces histoires. On n'en trouve pas beaucoup.
On s’est intéressé au documentaire de Sophia Fischer, Mères à perpétuité, qui a interviewé des mères qui sont en prison à perpétuité, pour avoir tué leurs enfants. Principalement, elles ont raté leurs suicides puisque, généralement, c’est dans le désir de se donner la mort qu’elles donnent la mort à leurs enfants.
Justement pour ne pas qu’ils vivent la même histoire qu’elles-mêmes.
Et parfois, aussi, ce sont les familles de ces femmes-là qui racontent leurs histoires. On s’est rendu compte que c’était un peu comme une boîte noire qui n’est jamais ouverte puisque les bourreaux et les victimes, généralement, meurent. Donc il n’y a pas d’enquête. Et quand on donne la parole à ces femmes-là ou à ces familles, on se rend compte qu’elles ont toutes victimes soit de violences conjugales soit d’inceste dans leur enfance. En tous cas, elles sont inclues dans cycle, un cercle de violence qu’elles vont finalement perpétuer.
Alors, ce n’est pas pour excuser le geste mais c’est pour le comprendre. Et c’est ce que l’on essaie de faire dans cette version de Médée, où l’on donne à Médée un pendant contemporain. Une femme, une comédienne dans notre version, qui représente la Médée contemporaine, celle dont on dit qu’elle souffre du syndrome e Médée, qui a, dans notre version, assassiner ses enfants, comme Médée, et qui se retrouve en prison à perpétuité. Et les enfants de la pièce, qui ont un rôle important chez Cherubini, sont à la fois les enfants de cette femme en prison et les enfants de Médée. Ce sont eux qui font le lien entre les deux.
L’espace scénique de Médée est assez simple. Ce sont trois murs noirs, avec une sorte de meurtrière qui s’ouvre sur un cyclorama qui est pour nous l’espace imaginaire, celui des enfants. Les enfants ont une place dans le livret mais ils n’ont pas la parole. Et moi, j’avais envie de leur donner la parole parce qu’ils sont lien charnel entre Jason et Médée et le lien politique entre Créon et Jason puisque Créon leur offre l’asile en retour de la toison d’or, qui est les richesses volées dans le pays d’origine de Médée.
Pour moi, ces enfants sont ceux qui écoutent les histoires des grands qui se racontent, un peu comme dans un théâtre de ficelles, l’épopée, le mythe de leurs parents. Ce sont ceux à qui on ne donne pas la parole et qui seront présents, comme une voix off qui raconte leurs peurs, qui raconte leur vision de l’histoire de leurs parents. Donc ils comme des enfants d’aujourd’hui vivant le divorce des plus grands.
Donc ça, c’est pour l’espace imaginaire mais c’est aussi un espace réaliste qui peut héberger le palais de Créon, l’église dans laquelle vont se marier Dircé et Jason, la chambre dans laquelle Médée vivra ses derniers instants avec ses enfants. Et c’est aussi l’espace de la prison, représentée par cette meurtrière, dans lequel notre comédienne, cette Médée contemporaine, revisite ses pensées, ses souvenirs fragiles, qu’elle a vécu avec ses enfants avant ce geste ultime. »
« Pour nous, Médée n'est pas un monstre. C'est sans doute la société qui créé les monstres autour d'elle. »
Marie-Ève Signeyrole Metteuse en scène
Opéra-comique de Luigi Cherubini en trois actes. Livret de François-Benoît Hoffman. Créé le 13 mars 1797 au Théâtre Feydeau. Nouvelle production.
Direction musicale, Laurence Equilbey • Mise en scène, Marie-Ève Signeyrole • Avec Joyce El-Khoury, Julien Behr, Edwin Crossley-Mercer, Lila Dufy, Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, des solistes de l’Académie, des enfants de la Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique • Orchestre, Insula orchestra • Choeur, accentus