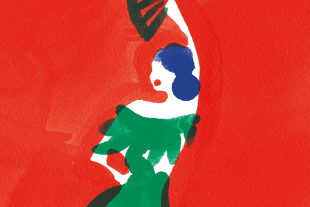Parmi les innombrables héroïnes de la scène lyrique, Carmen appartient à une lignée très minoritaire de rôles-titres confiés à une mezzo-soprano. Cette voix, qui demeure intermédiaire dans les tessitures féminines entre soprano et contralto, s’impose d’emblée comme consubstantielle au personnage.
Est-ce à dire qu’elle procède d’un choix audacieux du compositeur, déterminé à marquer la singularité de sa figure de gitane ainsi que son caractère fatal – la voix haute étant traditionnellement à l’opéra l’apanage de la jeunesse et de l’innocence ?
Si la présence dans la troupe de l’Opéra Comique d’une interprète aussi remarquable que Célestine Galli-Marié a déterminé Bizet à faire de sa bohémienne maléfique une mezzo, la conjonction du rôle et de la voix s’explique tout autant par l’histoire des tessitures féminines dans l’art lyrique français.
En effet, la musique vocale française a toujours valorisé les tessitures intermédiaires. Dans le sillon tracé par Lully, le Siècle des Lumières voit naître les grandes figures dramatiques que sont Médée, mise en musique par Charpentier (1693), puis Phèdre, puissamment dessinée par Rameau dans son Hippolyte et Aricie (1733), et bien d’autres. On n’utilise guère alors que le terme de dessus – ou soprano – pour désigner l’ensemble des rôles aujourd’hui distribués tantôt à des sopranos tantôt à des mezzos.
Dans son ensemble, qu’il s’agisse de la France ou des différentes écoles italiennes baroques, la typologie vocale privilégiait les voix centrales. La vocalité romantique ainsi que la hausse régulière du diapason au XIXe siècle ont transformé le goût et notre conception même de la virtuosité vocale. Une diva comme la Vénitienne Faustina Bordoni (ca. 1695-1781), qui régna presque sans partage sur les scènes d’opera seria et créa nombre de rôles de Haendel et de son époux Hasse, était une mezzo au timbre grave. D’une façon générale, le chant baroque doit beaucoup aux castrats, idoles mais aussi pédagogues de leur époque, qui développèrent le bel canto dans la rapidité, l’endurance et la maîtrise virtuose des nuances. Leur art favorisait la richesse des notes du médium de la voix plutôt que les extrêmes de la tessiture, qu’ils atteignaient en changeant de registre.

Faustina Bordoni © Austrian National Library
Si les Français du XVIIIe siècle échappent peu ou prou à l’influence des castrats, d’autres considérations les rivent depuis Lully à une vocalité centrale. La première d’entre elles est l’importance accordée au texte dans l’art lyrique hexagonal : l’opéra national est d’abord un théâtre. On l’appelle d’ailleurs, depuis sa fondation par Louis XIV, tragédie en musique ou tragédie lyrique pour éviter le terme italien d’opera, et il reste étroitement connecté à la littérature par son écriture et par ses thèmes depuis qu’un académicien, Philippe Quinault, a formalisé pour Lully sa structure et son vers. Le texte du livret doit être intelligible car c’est lui qui, longtemps, motive seul la composition : on a ainsi pu reprocher à Rameau de mettre trop de musique dans ses œuvres et d’émanciper le discours musical de la trame verbale.
À cette exigence, le compositeur français, qu’il se consacre à l’opéra ou à l’opéra-comique, répond d’une part en restant toujours soucieux de la prosodie, d’autre part en maintenant le chant lyrique à une place centrale. Malgré ou grâce au repoussoir que constitue l’opéra italien, où le beau chant des castrats et de leurs partenaires est conçu comme une fin en soi et peut s’émanciper de tout souci d’articulation du texte, le chant français demeure constamment connecté à sa fonction première : exprimer une parole en musique.
Mozart puis les romantiques italiens élargiront les tessitures vocales. Leurs œuvres déterminent une typologie de rôles plus variée, avec la multiplication des travestis par exemple, à l’instar de Cherubino et plus tard du Roméo des Capuleti ed i Montecchi (1830) de Bellini. Le développement du répertoire entraîne l’apparition de profils vocaux plus contraignants, aux définitions assez strictes sur lesquelles se modèlent l’apprentissage du chanteur puis le recrutement dans les troupes, où la hiérarchie distingue prime et seconde donne. Le chant des castrats, lui, influence directement l’apparition du contralto rossinien : tessiture de Tancredi dans l’opéra homonyme (1813), de Rosine dans Le Barbier de Séville (1816) ou encore d’Isabella Colbran, épouse du compositeur et créatrice de nombreux rôles marqués par l’esprit romantique.

Isabella Colbran Rossini © BnF
Toutes ces influences convergent vers Paris, alors capitale musicale de l’Europe, dans la première moitié du XIXe siècle et l’aura d’une interprète exceptionnelle comme Maria Malibran (1808-1836) ne peut qu’influencer l’évolution des voix françaises. Une hybridation se produit alors dans le registre français du dessus et la mezzo commence à se distinguer nettement de la soprano. Le grand opéra romantique français illustre cette nouvelle typologie et, dans les rôles de Rachel (La Juive d’Halévy, 1835) et de Valentine (Les Huguenots de Meyerbeer, 1836), Cornélie Falcon impose une voix de soprano dramatique centrale au timbre grave.
Au milieu du XIXe siècle, le répertoire, le registre et les emplois de la mezzo-soprano sont bien établis. Si l’opéra romantique italien et allemand lui refusent le titre convoité de « protagoniste » (Azucena dans Le Trouvère de Verdi en 1853, Ortrud dans Lohengrin de Wagner en 1850), c’est le moment où Pauline Viardot (1821-1910) crée la Fidès du Prophète (1849) de Meyerbeer puis la Sapho (1851) de Gounod. Les grands rôles se multiplient dans l’ensemble du répertoire français contemporain. À la suite de Gluck et de ses héroïnes de tessiture « centrale », Berlioz privilégie la mezzo aiguë pour une large majorité de ses rôles féminins. Il en va de même au théâtre bouffe avec les créations d’Offenbach : Metella, Hélène, la Périchole. Cette voix-là évince peu ou prou la contralto de la scène lyrique, lui empruntant sa couleur grave et sa maîtrise du registre central tout en étendant sa capacité dans l’aigu. Surtout, demeurant au croisement de la soprano et de la contralto, les rôles qui lui sont destinés sont moins pensés en termes de catégorie vocale que conçus pour une interprète dont la personnalité (scénique autant que vocale) peut s’accorder avec un personnage donné.
Enfin, on ne peut séparer l’épanouissement de cette vocalité de mezzo sans évoquer celle qui lui fait face, la soprano : elle motive la création du personnage de Micaëla dans Carmen en 1875. Avec le développement de son registre résolument virtuose et aigu, la soprano a gagné une identité très forte mais qui, dès l’Ancien Régime, l’a privée de certains personnages bien marqués par la littérature qui inspire l’opéra, comme nombre d’héroïnes tragiques.

Micaëla dans Carmen en 1875 © BnF
C’est ainsi que le rôle de Carmen est plus caractéristique en terme de couleur qu’exigeant en termes de virtuosité et de tessiture – ce qui sera le cas de la Dalila de Saint-Saëns (1877) et de l’Hérodiade de Massenet (1881) dans des œuvres créées juste après. On pourrait alors dire que la voix de Carmen est une page blanche, non d’un point de vue historique car elle a de nombreuses ancêtres, dont la Mignon d’Ambroise Thomas, également créée par Célestine Galli-Marié en 1866, mais parce qu’elle est accessible à presque toutes les voix féminines possédant une bonne assise du médium, ce qui ne fait défaut qu’à la soprano colorature. Galli-Marié était une mezzo de tessiture élevée mais au timbre grave : le destin de Carmen sur les scènes du monde entier (sans parler d’un siècle d’enregistrements !) montre que de nombreuses sopranos ont interprété ce rôle écrit pour elle. On a même connu des Micaëla qui n’ont pas su résister à l’appel du rôle-titre !
Parce que la question de la couleur, question éminemment française, compte davantage que celle de l’ambitus, le chef d’orchestre est amené à faire, lorsqu’il « distribue » le rôle de Carmen, un choix déterminant pour le profil de ce personnage marqué par l’audace, l’indépendance et une certaine rouerie – le contraire d’une jeune première ! Autrement dit, l’identité de Carmen réside d’abord dans la couleur vocale de son interprète et, si une voix grave « qui monte » lui convient sans doute mieux qu’une voix haute « qui descend », un Cherubino qui a mûri peut l’interpréter aussi bien qu’une Amneris qui se contient.
La grande satisfaction de ses interprètes réside dans le fait que, si la voix de Carmen est essentiellement une couleur, et une couleur historiquement française, avec les mots et la conversation qui vont avec, l’écriture du rôle permet d’y déployer toutes les couleurs de la voix féminine.